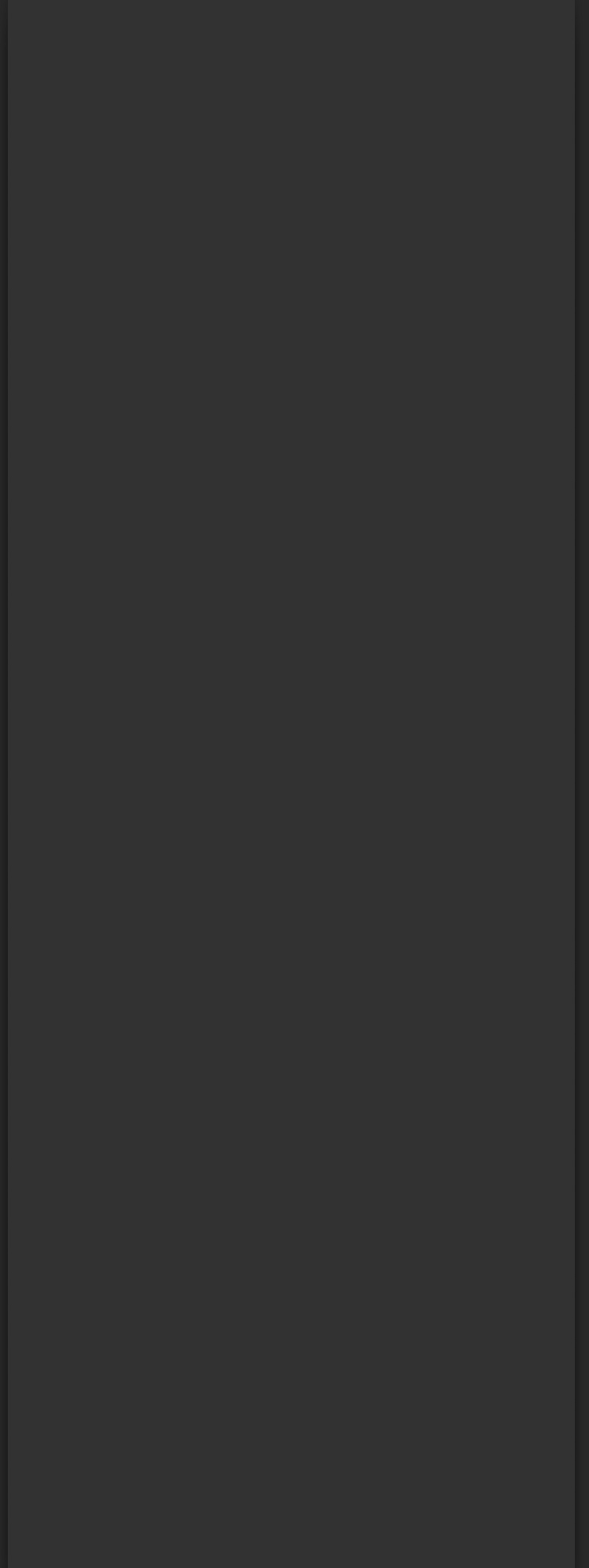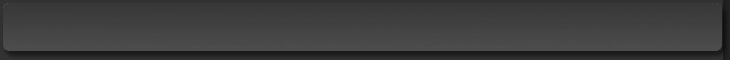Déclarations royales du 13 décembre 1698 et du 14 mai 1724 :
«Voulons, que l’on établisse autant qu’il sera possible des maîtres et des maîtresses dans toutes les paroisses où il n’y en a point, pour instruire tous les enfants du catéchisme et des prières qui sont nécessaires et nommément ceux dont les pères et mères ont fait profession de la religion prétendue réformée... comme aussi pour apprendre à lire et même à écrire à ceux qui pourraient en avoir besoin ; et que dans tous les lieux où il n’y aura point d’autres fonds, il puisse être imposé sur tous les habitants la somme qui manquera pour leur subsistance jusqu’à celle de 150 livres par an pour les maîtres, et 100 livres pour les maîtresses...
Enjoignons à tous les pères et mères, tuteurs et autres personnes qui sont chargées de l’éducation des enfants, de les envoyer aux dites écoles et au catéchisme jusqu’à l’âge de quartorze ans et nommément les fils des anciens protestants...»
«...enjoignons aux curés de veiller avec une attention particulière sur l’instruction desdits enfants dans les paroisses... Exhortons et néanmoins enjoignons aux évêques de s’en informer soigneusement ...»
Vers la fin du XVIIe siècle, la majorité des écoles de garçons étaient tenues par les vicaires ou par les curés. Au début du XVIIIe siècle, la diminution progressive du nombre des ecclésiastiques, obligeait les paroissiens et les curés à recourir à des clercs ou maîtres laïques. Ils étaient nommés par la Communauté d’habitants (assemblée à l’issue des offices religieux) et étaient liés par un contrat civil indiquant la durée d’engagement et la période scolaire. Certaines localités possédaient des écoles fondées par des particuliers. Un seigneur bienfaisant, un riche bourgeois, une dévote aisée, affectaient par testament une somme d’argent à leur établissement, et souvent des biens légués soit à la communauté ou à l’église étaient destinés à perpétuer cette institution utile. Il se pouvait aussi qu’on se passait d’instruction quand l’instituteur coûtait trop cher et que le curé ne pouvait exercer en plus de ses fonctions cultuelles celles non moins absorbantes de maître d’école.
Les maîtres étaient peu instruits et leur discipline était dure et parfois brutale. Avant d'enseigner, ils avaient souvent exercé d'autres professions : "notaire, charron, sacristain, boucher, laboureur, sergent civil, parfois anciens soldats du roi,...".
Ils ne touchaient que quelques sous par mois pour chaque élève au moyen de l'écolage, quelques dons en nature ou une faible subvention de la communauté ; ils vivaient misérablement et la salle de classe était à l'image de leur dénuement. Leur situation précaire, dépendante et peu stable, n'était ni recherchée ni honorée.
Les punitions corporelles étaient plus que jamais à l’ordre du jour au XVIIIe siècle. La plus douce, était la mise à genoux, puis venaient le bonnet d’âne, les coups de baguette, de férule, de pétoche, de martinet, la séquestration avec privation de nourriture, et enfin le renvoi.
Ces moyens disciplinaires ne pouvaient produire que de tristes résultats au point de vue du caractère des enfants ; aussi, les ligues, les révoltes et même les batailles entre le maître et les élèves étaient-elles fréquentes ! A l’origine dans les écoles des frères, la correction corporelle était non seulement admise mais règlementée avec précision.
La plus large place était réservée à l’enseignement et aux exercices religieux. La lecture des livres imprimés, et, pour les élèves les plus avancés, celle des vieux contrats, l’écriture, les éléments du calcul, quelques exercices de mémoire, des travaux de couture et de dentelle, pour les filles, voilà tout ce qui, avec étude du catéchisme, des prières et la récitation du chapelet, constituait le programme des anciennes écoles. Avant d’apprendre à écrire, il fallait savoir lire ; avant d’apprendre à compter, il fallait savoir lire et écrire. Le mode individuel était à peu près le seul en usage ; pendant que le maître s’occupait d’un écolier, les autres restaient sans rien faire. Ce n’est que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qu’on recommande de faire en sorte que toutes les divisions d’une même classe soient occupées à la fois. Généralement, l’école se divisait en trois classes ou trois leçons : la première pour les enfants commençant à connaître les lettres et à apprendre les prières ; la deuxième pour les enfants apprenant à lire en français, puis en latin, le catéchisme et les prières plus développées. La troisième leçon ou classe comprenait les élèves sachant lire dans la civilité et dans les manuscrits en écriture courante et gothique ; ceux-ci apprenaient à écrire l’arithmétique et à calculer avec la plume et des jetons.
Les heures d’ouverture des écoles rurales variaient selon les habitudes de chaque région. Les jours de classe subissaient certaines modifications à cause des foires et marchés et des occupations du clerc.
Les livres les plus répandus étaient : l’Alphabet, dit Croix de Dieu, la Vie de Jésus-Christ, le Psautier de David, les Pensées chrétiennes, le Pensez-y bien, l’Histoire abrégée de la religion, la Civilité puérile et honnête, les Contes de Perrault, l’Histoire des quatre fils Aymon, etc.
Des progrès s’accomplirent dans les méthodes pédagogiques, notamment avec l’arrivée des Eléments de la grammaire française de Lhomond (1780).
Louis XIV après la révocation de l’Edit de Nantes et pour achever son œuvre de prosélytisme intéressé, voulut astreindre tous les enfants des protestants à fréquenter l’école catholique. Les ordonnances de 1695 et 1698, achevèrent la destruction des écoles protestantes et placèrent entièrement les petites écoles entre les mains du clergé. Il fallait donc que des écoles fussent ouvertes où il en manquait, pour permettre l’application intégrale de l’Edit. Il aurait eu au moins pour résultat de multiplier les écoles et d’améliorer en la régularisant la situation des recteurs, si son exécution n’avait pas été entravée par des obstacles de toute nature : opposition de certains parlements et indifférence des curés de paroisses.