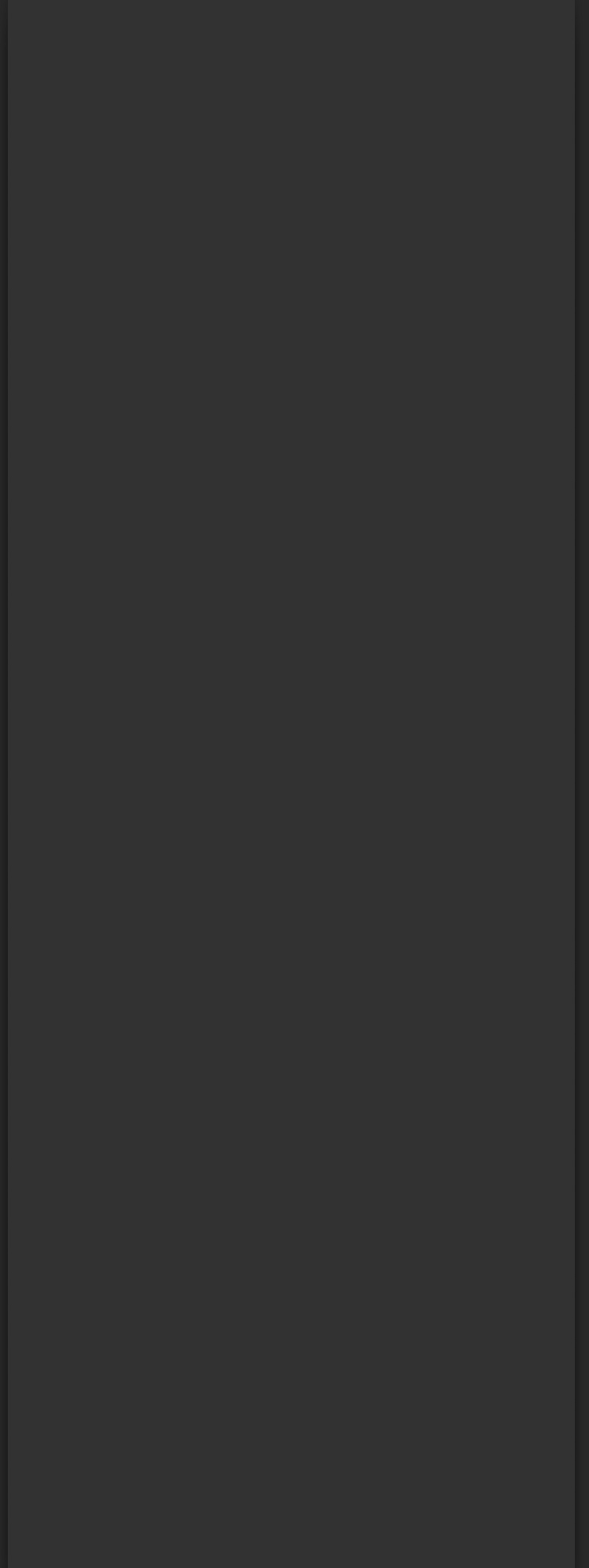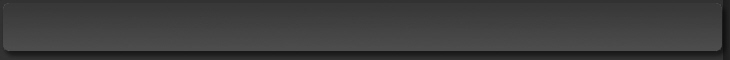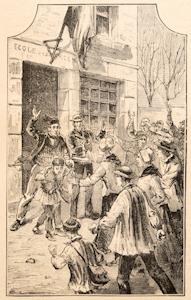La 3ème République de 1970 à 1914
Après la défaite contre la Prusse, les Parisiens se soulèvent et la
IIIe République est proclamée le 4 septembre 1870.
La France édifie un Empire colonial.
La Marseillaise est adoptée comme hymne national.
Le 14 juillet est déclaré fête nationale.
Paul Bert fait adopter sa loi sur l'établissement obligatoire des écoles normales primaires du 9 août 1879.
Il est le rapporteur du projet déposé par M. Waddington, ministre de l'instruction publique en mars 1877, créant une caisse pour la construction des maisons d'école (sera la loi du 1er juin 1878).
Ce fut le 6 décembre 1879 que Paul Bert dépose, au nom de la commission qu'il préside, un projet de refonte complète de toute la législation de l'instruction primaire qui consacre le triple principe de l'obligation, de la gratuité, de la laïcité, substitue à l'autorité des préfets celle de directeurs départementaux de l'enseignement primaire, modifie la composition et les attributions des Conseils départementaux, assure aux instituteurs des traitements plus élevés et des garanties nouvelles, et prépare l'élimination graduelle du personnel congréganiste. Jules Ferry, ministre de l'instruction publique, d'accord avec le rapporteur sur toutes les questions de principe, estime toutefois qu'un projet aussi étendu et aussi complexe aboutirait difficilement à une solution. Il juge plus pratique de s'attaquer d'abord aux questions les plus urgentes et, à cet effet, présente successivement à la Chambre trois projets distincts : celui sur les lettres d'obédience et le brevet de capacité (sera la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité), puis ceux sur la gratuité absolue de l'enseignement primaire et sur l'instruction primaire obligatoire (seront les lois du 16 juin 1881 sur la gratuité, et du 28 mars 1882 sur l'obligation). Pour cette dernière, la commission avait ajouté au projet du ministre la laïcité des programmes. Elle avait détaché du projet d'ensemble, suivant l’exemple du ministre, les dispositions relatives au classement et aux traitements des instituteurs et institutrices pour en fait une proposition de loi spéciale discutée et adoptée le 28 juillet 1881.
Jules Ferry s'adresse directement aux instituteurs par une lettre dont un exemplaire est envoyé à chacun d'eux. Le but de cette lettre est d'expliquer la signification de l'instruction morale et civique que la loi nouvelle charge l'instituteur de donner à ses élèves, et qui prend dans le programme la place occupée autrefois par l'instruction morale et religieuse. Cependant un amendement de Jules Simon contraint l'instituteur à enseigner à ses élèves "leurs devoirs envers Dieu et la patrie".
Des manuels nouveaux et revues pédagogiques fleurissent. Tous respirent le plus vif amour de la patrie. Le patriotisme unifie la France. Des bataillons scolaires sont organisés et Jean Macé écrit :"L'important, c'est de commencer tout de suite et de donner aux campagnes de France le spectacle de leurs enfants se préparant, dès l'école, à défendre le sol de la patrie, si jamais l'étranger essayait de revenir le fouler."
Proposée par Paul Bert, présentée par Jules Ferry et défendue avec ardeur par Goblet, la loi du 30 octobre 1886 établit la laïcité du personnel enseignant primaire ; elle abolit les derniers vestiges du régime de privilège que la loi Falloux avait assuré aux congrégations enseignantes, elle décide que, dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement serait exclusivement confié à un personnel laïque. De là le nom de loi sur la laïcité.
La liberté d’association est instituée en 1901.
En juillet 1904, interdiction est donnée à tous les congréganistes d'enseigner.
En 1905, la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat est votée. La république, désormais, ne reconnaît ni ne salarie aucun culte ; l'Eglise ne relève plus que du Saint-Siège.
Les maires sont élus.
Le Boulangisme, puis l'affaire Dreyfus révèle l'existence d'une droite nationaliste qui met en l'armée tous les espoirs de reconquête politique de la France. Par contre, une fraction de la gauche est séduite par l'humanisme et le pacifisme.
La Ligue de l'Enseignement renonce à sa devise : "Pour la Patrie, par le livre et par l'épée". Les maximes patriotiques qui ornaient les cahiers d'écoliers disparaissent.
La montée des nationalismes, l'activisme des revanchards et l'assassinat du pacifiste Jean Jaurès, le 31 juillet 1914, conduisent à la guerre.